Je retranscris ci-dessous une contribution au journal en ligne allemand The European (ainsi que la version allemande parue sur leur site)

La perte du AAA français, une bonne nouvelle pour l’Europe ?
La dégradation par Standard&Poor’s de la note souveraine de la France et de quelques autres pays européens était largement anticipée par les marchés et les analystes financiers. En outre, comme on s’y attendait, la perte du AAA français a entraîné mécaniquement celle du Fonds Européen de stabilité financière (FESF) dont la capacité d’intervention est désormais réduite à moins de 300 milliards d’euros. L’intervention du FMI apparaît inéluctable pour secourir la Grèce, le Portugal ou même l’Italie. Mais au-delà des conséquences de cette décision sur le coût de refinancement des pays et entités publiques concernées, il faut analyser ses répercussions à moyen et long terme.
En France, cette décision sanctionne la politique économique du président Nicolas Sarkozy mais aussi celle de ses prédécesseurs des trente dernières années, qu’ils soient de gauche ou de droite. Contrairement à l’Allemagne qui a axé sa stratégie de croissance sur la promotion des entreprises de taille intermédiaire – le Mittelstand - et a bâti une économie décentralisée après la seconde guerre mondiale, la France a privilégié un modèle fondé sur de grandes entreprises dirigées par des hauts fonctionnaires qui a permis de soutenir la consommation et de financer les dépenses publiques, mais qui s’est ensuite « grippé » à mesure que ces entreprises s’internationalisaient et échappaient à la pression fiscale nationale. A l’absence de renouvellement du tissu productif et au sentiment d’une « désindustrialisation » subie qui favorise l’essor du populisme et du protectionnisme, se conjuguent la difficulté de renouvellement des élites issues du baby boom, et la faillite de la politique d’intégration des populations immigrées.
Les conséquences européennes de la décision de Standard&Poor’s, elles sont liées avant tout à l’absence de volonté politique, de la part de l’Allemagne et de quelques autres Etats « vertueux » d’aller vers un fédéralisme budgétaire et fiscal qui impliquerait une solidarité plus forte avec les pays du « Club Med ». Cela s’explique par la « fatigue institutionnelle » ressenti par les habitants de ces pays à la suite de la réunification allemande et de l’élargissement à marche forcée de l’Union Européenne dans les années 2000. En outre, le traité de Lisbonne de 2009 a renforcé la logique intergouvernementale, au détriment de la logique supranationale et de l’esprit du traité de Rome de 1957, sans toutefois atteindre le consensus nécessaire pour dépasser la crise actuelle. Même s’ils ont sans doute évité le pire, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel n’ont pas su transformer la crise en opportunité. Ils n’ont pas su se hisser à la hauteur historique des couples De Gaulle - Adenauer ou même Mitterrand-Kohl.
Quant aux marchés financiers qui ont été beaucoup critiqués, ce qu’ils demandent ce n’est pas moins d’Europe, mais au contraire une Europe renforcée dans ses fondations et dans sa gouvernance économique et monétaire. Au niveau technique, les solutions sont connues : instauration d’une fiscalité européenne, émission d’euro-obligations, mise en place d’un ministère des finances de la zone euro. Mais il faut aller plus loin, avec l’élection au suffrage universel d’un président de l’Union européenne, le renforcement du contrôle du parlement européen sur les budgets nationaux et le développement d’une politique industrielle qui fasse contrepoids à la politique de la concurrence. Tout cela nécessitera sans doute une nouvelle génération de leaders. En ce sens, la décision de Standard&Poor’s est salutaire.
Frankreichs Bonität : Traut euch
Die Herabstufung Frankreichs durch die Rating-Agentur Standard & Poor’s ist ein Fanal für Paris und die gesamte Union. Die bisherige Industriepolitik des Landes wird damit gebrandmarkt. Doch die Märkte fordern mehr Europa, nicht weniger.
Die Herabstufung Frankreichs und weiterer europäischer Länder durch Standard & Poor’s war von den Märkten und den Finanzanalysten erwartet worden. Der Verlust der Top-Note zog die Herabstufung des EFSF nach sich – auch das war erwartet worden. Dessen Reaktionsfähigkeit ist jetzt auf 300 Milliarden Euro reduziert. Eine Intervention des IWF scheint nunmehr unvermeidlich, um Griechenland, Portugal und eventuell sogar Italien zu retten. Neben den steigenden Refinanzierungskosten für die betroffenen Länder muss man aber auch die mittel- und langfristigen Auswirkungen bedenken.
Nährboden für Populismus
Mit der Entscheidung bestraft Standard & Poor’s nicht nur die Wirtschaftspolitik von Nicolas Sarkozy, sondern auch die seiner Vorgänger der letzten 30 Jahre, unabhängig davon, ob sie links oder rechts waren. Deutschland hat seine Wachstumsstrategie auf die Förderung des Mittelstandes ausgerichtet und nach dem Zweiten Weltkrieg eine dezentralisierte Wirtschaft aufgebaut. Im Gegensatz dazu bevorzugte Frankreich ein Modell, das sich auf große, von Beamten geführte Unternehmen stützte. Anfangs kurbelte dies zwar den Konsum an und ermöglichte die Finanzierung von öffentlichen Ausgaben. Als die Unternehmen sich aber zunehmend internationalisierten und der französischen Steuerlast entflohen, schmolz dieser Effekt dahin. Die wirtschaftliche Strukturschwäche fühlte sich fast wie eine De-Industrialisierung an und war ein Nährboden für Populismus und Protektionismus. Hinzu kommt nun noch das Problem, dass den Eliten der Baby-Boom-Generation niemand nachwächst, und dass die Integrationspolitik weitgehend versagt.
Die europäische Dimension der Entscheidung von Standard & Poor’s ist in erster Linie ein Appell an den politischen Willen Deutschlands und der anderen „braven“ Staaten, einen Haushalts- und Fiskalföderalismus aufzubauen. Das würde nämlich eine stärkere Solidarität mit den Ländern des Club Med (Mittelmeerstaaten) bedeuten. Der fehlende politische Wille in Deutschland und den anderen „braven“ Staaten resultiert vor allem aus dem Institutionenverdruss der Bewohner in Folge der deutschen Wiedervereinigung und der großen EU-Erweiterung der 2000er-Jahre. Darüber hinaus hat der Vertrag von Lissabon die zwischenstaatliche Logik zu Lasten der supranationalen Logik in den Römischen Verträgen verstärkt, ohne dabei jedoch den Konsens zu erreichen, der zur Überwindung der aktuellen Krise notwendig wäre. Auch wenn sie zweifellos das Schlimmste verhindert haben, so sind Nicolas Sarkozy und Angela Merkel doch daran gescheitert, die Krise in eine Chance zu verwandeln. Sie haben es nicht geschafft, auf die historische Augenhöhe ihrer Vorgänger-Paare – De Gaulle/Adenauer und Mitterrand/Kohl – zu gelangen.
Mehr Europa
Die Finanzmärkte wurden viel kritisiert. Sie fordern jedoch nicht weniger Europa, sondern im Gegenteil ein in seinen Grundfesten und in seinem Wirtschafts- und Finanzregelungssystem gestärktes Europa. Auf der technischen Ebene sind die Lösungen bekannt: ein europäisches Steuersystem, die Ausgabe von Euro-Bonds sowie ein Finanzministerium für die Euro-Zone. Man muss aber noch weiter gehen: die allgemeine, direkte Wahl eines Präsidenten der Europäischen Union, eine stärkere Kontrolle der nationalen Haushalte durch das EU-Parlament und eine entschlossene Industriepolitik als Gegengewicht zur Politik der Konkurrenz. Dafür braucht es zweifelsohne eine neue Generation von Führungskräften. In diesem Sinne ist die Entscheidung von Standard & Poor’s heilsam.
Übersetzung aus dem Französischen.
von Alexandre Kateb
23.01.2012




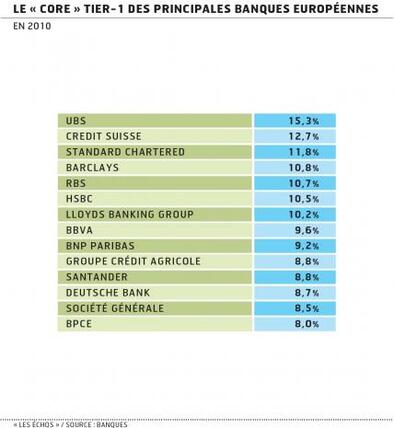

 Les turbulences qui se sont accentuées sur les marchés financiers durant la première semaine de mai - alors que l'acte « salvateur » de la crise grecque se jouait à Bruxelles - ont fait beaucoup penser aux événements de l'automne 2008. On a beaucoup parlé à cette occasion d'un retour de ce fameux « risque systémique » qui avait plongé la planète dans le chaos et le désarroi après que les autorités américaines de l'époque aient jugé inutile de voler au secours de la banque d'investissement Lehman Brothers, provoquant ainsi une vague de dislocations financières sans précédent.
Les turbulences qui se sont accentuées sur les marchés financiers durant la première semaine de mai - alors que l'acte « salvateur » de la crise grecque se jouait à Bruxelles - ont fait beaucoup penser aux événements de l'automne 2008. On a beaucoup parlé à cette occasion d'un retour de ce fameux « risque systémique » qui avait plongé la planète dans le chaos et le désarroi après que les autorités américaines de l'époque aient jugé inutile de voler au secours de la banque d'investissement Lehman Brothers, provoquant ainsi une vague de dislocations financières sans précédent.

